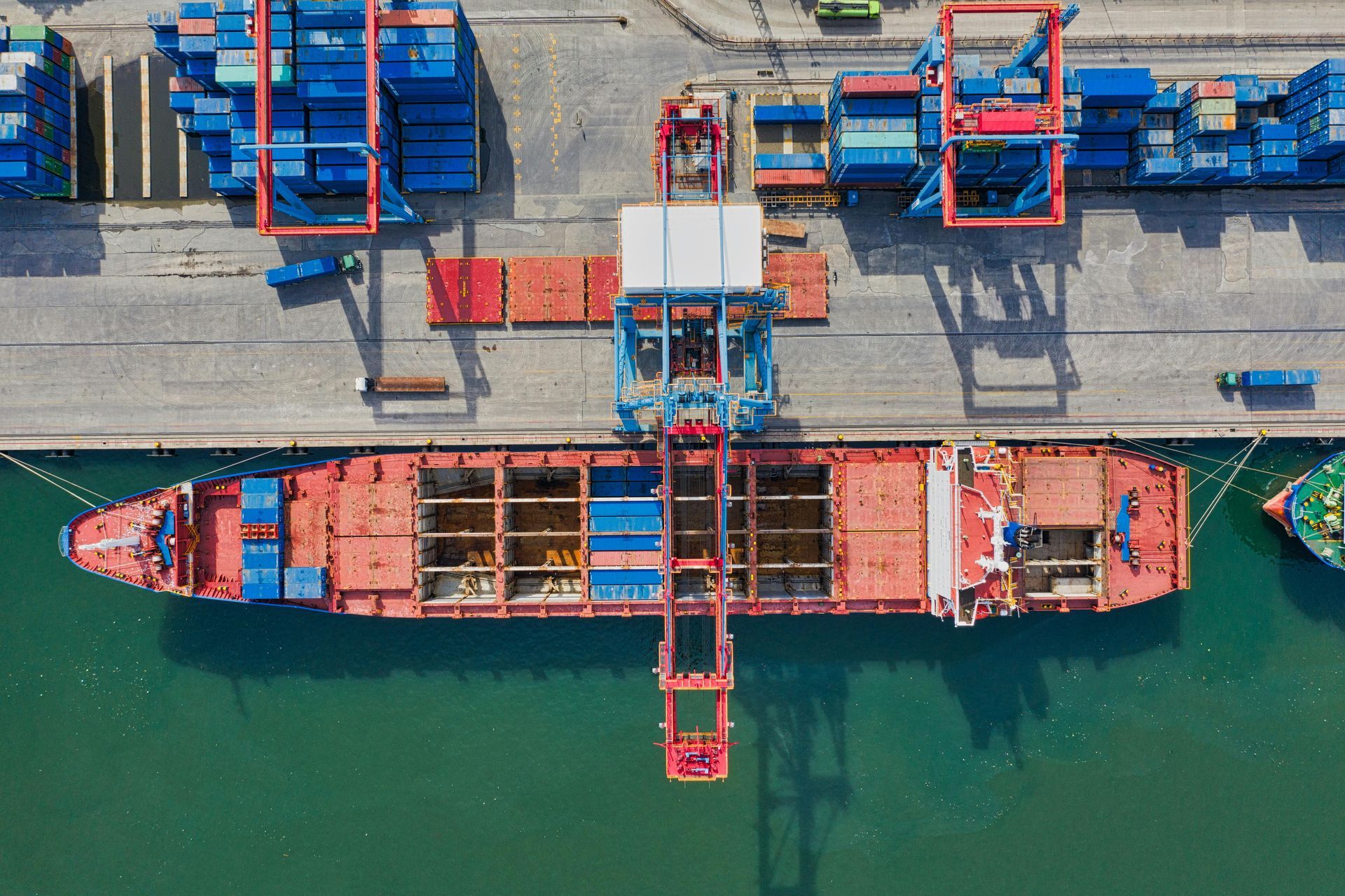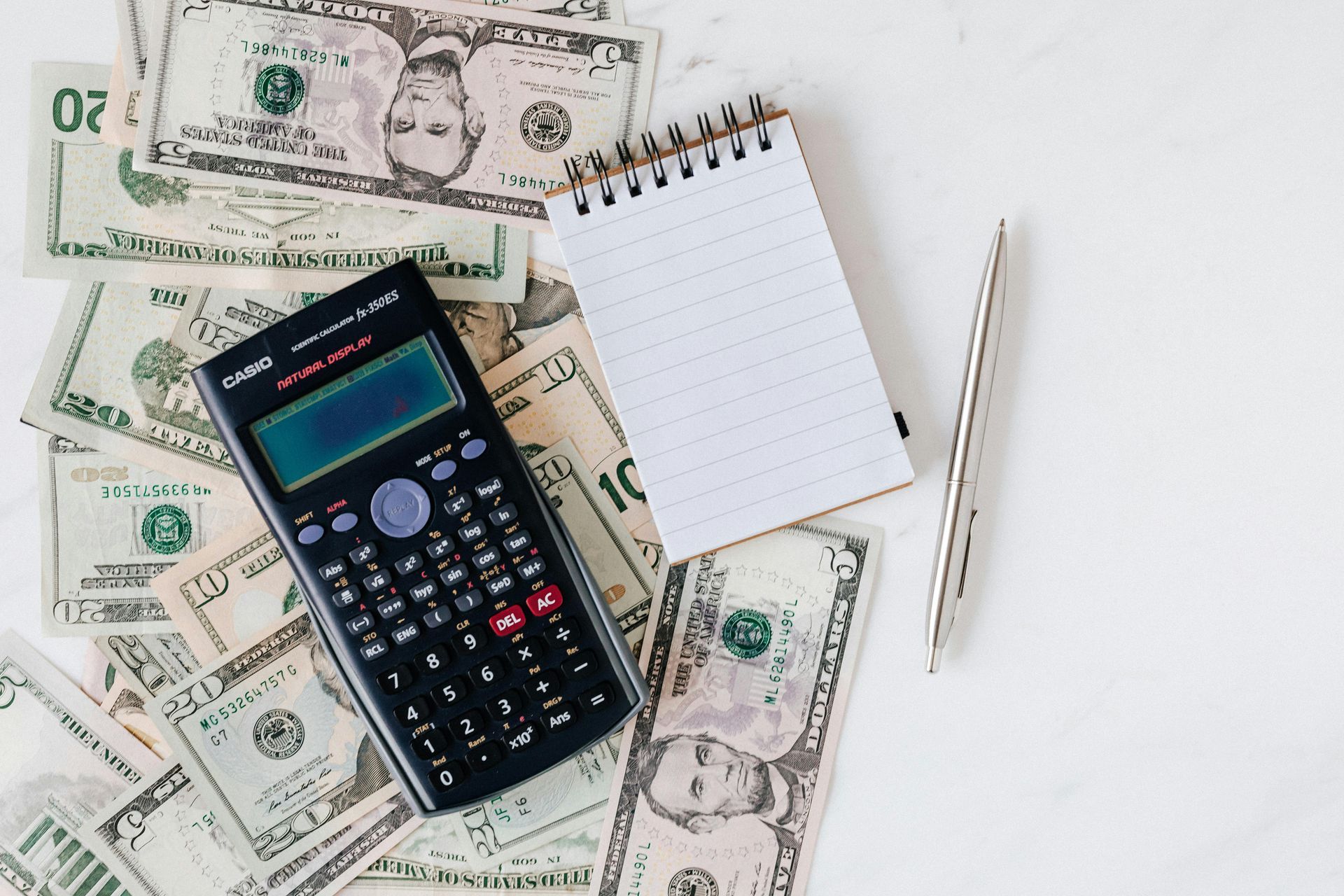Procédure de dépôt de marque au Maroc
La marque n’est pas seulement un signe distinctif destiné à identifier des produits ou services. Elle constitue un véritable patrimoine immatériel, porteur de valeur économique, de réputation et de confiance auprès des consommateurs. Pourtant, cette valeur attire inévitablement les convoitises : imitation, reproduction, ou utilisation frauduleuse par des tiers. C’est précisément ce que l’on appelle la contrefaçon.
La notion de « marque » se définit comme étant tout signe graphique, logo, slogan, nom, sigle, pseudonyme, ayant pour but principal d’assurer la distinction des produits et/ou services propres à une personne morale ou physique, ainsi que l’identification de ces derniers par tout client éventuel.
En dépit du fait qu’elle doit être distinctive, licite et disponible pour garantir son obtention, la protection de la marque s’avère primordiale dans la mesure où elle permet à son détenteur de bénéficier des droits exclusifs d’exploitation et donc, du droit de propriété absolu.
Cette protection tend également à priver toute autre personne souhaitant faire usage de la marque sans l’accord préalable du propriétaire de celle-ci, à défaut, cette dernière sera en mesure d’ester en justice pour contrefaçon.
A cet effet, avant de procéder à l’énonciation des formalités devant être observées afin d’assurer une protection optimale de la marque, il paraît primordial de relever les différents textes juridiques régissant cette matière :
- Décret n° 2-14-316 modifiant et complétant le décret n°2-00-368 pris pour l’application de la loi n°17-97 ;
- Dahir n° 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 31-05 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ; et
- Loi N° 23-13 modifiant et complétant la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle promulguée par le Dahir n°1.14.188 du 21 novembre 2014.
1.VERIFICATION D’ANTÉRIORITÉ
Avant d’entamer toute procédure inhérente au dépôt de la marque, il est opportun de consulter la base de données de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (ci-après dénommée « OMPIC »), afin de s’assurer qu’aucune marque identique ou similaire n’a déjà été enregistrée. Cette vérification d’antériorité permet de limiter les risques de rejet ou de litige ultérieur.
Suite à cette vérification d’antériorité, il convient de s’adresser à l’OMPIC (siège, l’une des agences régionales ou encore aux espaces dédiés de la Chambre de Commerce de Casablanca et la Chambre Française de commerce à Casablanca) pour le dépôt de celle-ci.
Le détenteur de la marque, personne physique ou morale, peut nommer un mandataire, obligatoirement domicilié au Maroc, habilité à accomplir toutes les formalités de dépôt.
2. CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article 144 de la loi 17-97, le dossier devant être fourni par le déposant ou son mandataire doit contenir les pièces suivantes :
- Le formulaire de dépôt M1 dûment rempli par le déposant (une demande d’enregistrement de marque qui sera inscrite au registre national des marques) ;
- Deux reproductions du modèle de la marque en noir et blanc ;
- Deux reproductions du modèle de la marque en couleur (dans le cas où la marque possède des couleurs spécifiques) ;
- Le paiement des droits exigibles ; et
- Le pouvoir ou procuration, habilitant le mandataire à déposer la marque en votre nom.
La demande d’enregistrement de la marque doit impérativement contenir une énumération exacte des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, cela conformément à l’arrangement de Nice relatif à la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques (Alinéa 4 de l’article 144 de la loi 17-97).
De même, l’article 144 dispose que le manquement de l’une des pièces susmentionnées donnera lieu à l’irrecevabilité de la demande, à défaut, un récépissé de dépôt sera immédiatement délivré.
3. TRAITEMENT DU DOSSIER
Suite au dépôt du dossier, l’OMPIC procède à l’examen de l’ensemble des pièces fournies, tant sur la forme que sur le fonds, afin de s’assurer que la marque répond aux exigences prévues par la loi (distinctive, licite et disponible).
La loi 17-97 octroie au déposant un délai de trois (03) mois allant de la date du dépôt, pour la régularisation du dossier. En cas de non-respect dudit délai, les dispositions de la loi 17-97 prévoit un délai supplémentaire de deux (02) mois afin de présenter une requête en poursuite de procédure. Une fois ces délais épuisés, la demande sera considérée comme annulée et par conséquent retirée, dans le cas contraire, le dossier conservera la date initiale.
En plus des éventuels manquements pouvant donner lieu au retrait du dossier ou le refus d’octroi de la marque, les dispositions des article 134 et suivants énumèrent les motifs de rejet d’une marque (contraire à l’ordre public par exemple, si elle contient des symboles religieux ou des représentations portant atteinte aux convictions spirituelles ou elle reproduit ou imite des emblèmes officiels protégés, tels que le drapeau national, l’emblème du Croissant-Rouge ou encore les sigles d’organisations internationales comme « ONU » ou « OMS », sans autorisation préalable).
Dans le cas où la demande répond aux différentes exigences prévues par la loi, celle-ci fera l’objet d’une publication, pour une période fixée à (02) mois, dans le catalogue officiel des marques accessible sur la plateforme web de l’OMPIC.
Cette publication a pour principale finalité de porter à la connaissance des tiers la demande d’enregistrement de ladite marque. (Ce délai permet également aux tiers de faire opposition contre la demande d’enregistrement).
4. ENREGISTREMENT DE LA MARQUE
Après l’épuisement de délai de deux (02) mois, et en l’absence d’opposition, l’OMPIC procède à l’enregistrement de la marque et sera tenu de remettre ou de notifier au déposant ou à son mandataire, un certificat d’enregistrement.
Ce certificat d’enregistrement de la marque, une fois délivré, permet au détenteur de la marque de jouir d’un droit de propriété exclusif pour tout produit et/ou service préalablement désignés et d’interdire, pour une durée de dix (10) années allant de la date d’obtention dudit certificat, toute tentative de contrefaçon ou d’exploitation illicite par un tiers n’ayant pas obtenu son aval.
5. LE RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE
Conformément aux dispositions de l’article 152 de la loi 17-97, la durée de protection de la marque est indéfiniment renouvelable. La demande de renouvellement de la protection devra être opérée dans les six (06) mois précédant l’arrivé à terme du délai de Dix (10) ans précités.
Ce renouvellement, portant essentiellement sur la marque figurant initialement dans le registre national des marques, commence à courir à compter de l’épuisement du délai susmentionné.
En cas de modification du signe, ou encore en cas de rectification au niveau des produits et/ou services désignés, une nouvelle procédure de dépôt devra alors être entamée.
6. TARIFICATION
Dans le cadre de la procédure d’enregistrement de la marque, l’OMPIC propose deux tarifications distinctes en fonction de la nature du client et du procédé de dépôt.
Bien que cet organisme favorise le dépôt du dossier par voie électronique, justifié par le coût inférieur de cette prestation au détriment du dépôt physique, l’OMPIC propose des tarifs différents selon la typologie des clients souhaitant enregistrer leur marque.
En effet, en se référant au tableau de tarification mis à la disposition des déposants ou leur mandataire, le tarif applicable aux TPE, PME, auto-entrepreneurs, universités, etc. demeure inférieur aux tarifs proposés aux autres usagers ne le relevant pas de la catégorie précédente.

Source : Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), barème officiel des taxes, mis à jour en 2025.